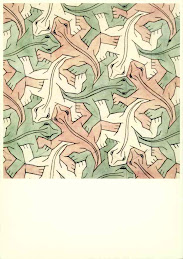J'emprunte au Parti communiste français cette affiche prémonitoire de janvier 2008
'La Bourse ou la vie, rendons l'argent utile' pour illustrer le texte des Gracques à paraître demain dans le journal Le Monde :
La Bourse ou la vie, le chantage des marchés.
Car après tout, cette affiche du PCF pourrait bien servir d'étendard aux dirigeants du
'G20' qui se réuniront à Washington en fin de semaine ;-)
Espérons au moins que Nicolas Sarkozy, Henry Paulson* et consort trouveront une solution pour rendre l'argent de la finance
moins nuisible, moins toxique, ce qui serait déjà un énorme progrès...
Retour au texte des Gracques donc, pour quelques mots de commentaire.
Faut-il y voir le signe de mon incompétence en macro-économie, ou le signe de notre impuissance collective ? Mais depuis le début de la 'crise', je m'intéresse beaucoup plus aux
questions soulevées par les analyses, les tribunes libres et les reportages, qu'aux prétendues solutions qu'ils assènent. Et le texte des Gracques n'y échappe pas.
Parmi les cinq solutions qu'ils proposent, plus d'une enfonce des portes grandes ouvertes et en reste aux bons sentiments : un peu plus de régulation, siouplé... Avec une naïveté confondante, inquiétante même quand on sait que
les Gracques rassemblent un bon nombre d'économistes de haut vol, la crème de la crème des anciens collaborateurs de François Mitterrand, Michel Rocard, Pierre Bérégovoy et Lionel Jospin.
Ainsi par exemple, la
1ère proposition des Gracques : mutualiser au profit du FMI et de la Banque mondiale,
les gains que les États tireront des plans de sauvetage des banques, afin de financer l'aide au développement des pays du Sud.
C'est le futur de l'indicatif qui me laisse rêveur... Si l'intention de l'aide au développement est louable, qui peut croire
aujourd'hui que les États tireront
forcément bénéfice de ces plans de sauvetage vertigineux ? Je ne trouve pas l'ombre du début d'une réponse dans
le texte des Gracques, si ce n'est cette curieuse analogie avec le temps des nationalisations. Je cite :
(...) Il n'est d'ailleurs pas certain que nos finances supportent une charge nette en fin de compte. Après tout, les nationalisations de 1981 ont été une bonne affaire pour les contribuables français, même si c'est pour de tout autres raisons que celles pour lesquelles elles avaient été décidées. (...)
C'est bien là tout le problème. Si les nationalisations ont été un acte politique choisi et assumé - que j'avais ardemment contesté, en son temps - les plans de sauvetage des banques sont d'une tout autre nature, comme le laisse entendre le titre même du texte des Gracques :
la Bourse ou la vie. Je cite :
(...) Les marchés ont réussi la plus grande prise d'otages de l'Histoire ; ils ont posé un pistolet sur la tempe des Etats et des contribuables. Ne vous demandez plus ce que votre banque peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre banque : la Bourse ou la vie... Les gouvernements ont cédé. Ils ont eu raison. Ils n'avaient pas le choix. (...)
Après un tel braquage à main armée, qui peut croire que les États et les contribuables récupèreront forcément leur mise, avec une plus-value ? Si un Prix Nobel d'économie passe dans les parages, les commentaires ci-dessous lui sont grand ouverts...
Les sommes engagées en couverture des banques sont gigantesques : 2500 milliards de dollars soit environ 2000 milliards d'euros dont 350 milliards d'euros en France, ce qui représente
10.000 euros par foyer fiscal c'est-à-dire
6 ans d'impôt sur le revenu !Qui peut croire que les institutions financières ne vont pas profiter aux mieux de ces
garanties colossales pour défendre leurs propres intérêts, en premier lieu ? Un tel matelas de sécurité, garanti sur le dos des contribuables, sera-t-il autre chose qu'une aubaine pour optimiser les profits des institutions financières, une fois leur survie assurée ?
Les pouvoirs publics sont-ils en situation de pouvoir obtenir
la contrepartie du secours qu'ils apportent au monde de la finance déjantée ? Rien n'est moins sûr. Comment les États vont-ils faire pour négocier quoi que ce soit, maintenant que les garanties ont été apportées aux banques ? On n'est pas chez les Bisounours !
Dans l'
océan de dérégulation dans lequel ils évoluent depuis des décennies, les acteurs financiers sont devenus des
requins de la pire espèce. De véritables
prédateurs comme on en a la preuve aujourd'hui...
D'ailleurs,
Henry Paulson*, secrétaire du Trésor étasunien, ne vient-il pas de faire marche arrière aujourd'hui même, en renonçant à racheter les créances pourries des banques, les renvoyant ainsi à leurs propres responsabilités ?
Le Trésor des Étas-Unis semble préférer engager les fonds en haut de bilan pour prendre part aux
actifs des banques fautives et participer activement aux décisions de leurs conseils d'administration ou de surveillance, en attendant un
hypothétique retour à meilleure fortune. Les dirigeants européens feraient bien de s'en inspirer dare-dare, avant qu'il ne soit trop tard !
Deux autres propositions des Gracques
ne cassent pas trois pattes à un canard :¶ — Oui, il faut mieux surveiller les fonds propres des opérateurs non régulés (sic) pour limiter les risques qu'ils font prendre au système financier tout entier !
¶ — Oui, il faut placer les agences de notations privées sous contrôle public. Moi, j'appelle ça le B.A BA de l'impartialité. On ne peut être à la fois juge et parti, comme le sont les agences de notation, en toute impunité. C'est con comme la séparation des pouvoirs... Montesquieu, au secours !
La recommandation suivante des
Gracques vaut son pesant de cacahuètes. Encore une litanie de bonnes intentions, sans l'ombre du début d'une solution concrète... Je cite :
¶ —
Imposer à tous les opérateurs de marché des règles de rémunération de la performance tenant compte de la durée, et surtaxer fiscalement ceux qui ne les respectent pas.Alléluia ! Bravo, c'est merveilleux. Juste un détail : comment fait-on ? Moi, je veux bien fiscaliser à 85 voire à 90% les rémunérations financières non réalisées 'dans la durée'. Mais sérieusement, faut-il scotcher les investisseurs dans la durée, au risque de les voir renoncer à leur engagement ?
Pour le financement de l'innovation par exemple, le capital d'amorçage et le capital développement sont deux choses différentes. L'hypothétique 'culbute' des investisseurs en capital risque est proportionnelle aux risques financiers qu'ils engagent. Quand ils perdent, ils perdent tout ou presque. Alors quand ils sortent gagnant ? Pas sûr que l'assomoir fiscal soit la meilleure solution puique leur risque est intrinsèquement lié à leur échéance de sortie... Et comment fixer la durée de référence pour analyser la performance ? Mystère et boule de gomme.
Voilà pour une première réaction à chaud, à la lecture de
ce texte des Gracques, fort intéressant encore une fois, mais discutable. Sans doute y reviendrais-je dans les prochains jours, au gré des accouchements possibles de notre fameux 'G20' à Washington !
* : Sieur
Henry Paulson, actuel secrétaire d'État au Trésor des États-Unis d'Amérique est également l'ancien dirigeant de la banque d'investissement Goldman Sachs...
MàJ du 14 novembre : on apprend ce soir que
Jean-Pierre Jouyet, secrétaire d'État aux Affaires européennes, va quitter le gouvernement pour rejoindre l'
AMF, le régulateur des marchés financiers. Un Gracques à l'AMF... Wait & see !